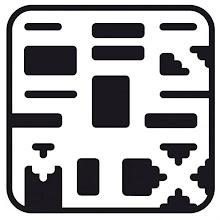Hier soir, j'ai regardé le DVD de "Je crois que je l'aime" de Pierre Jolivet (aucun de ses films n'est mauvais, je vous les conseille tous).
L'histoire commence par l'intervention d'une artiste (Sandrine Bonnaire) dans le hall d'une entreprise florissante dont le PDG est Vincent Lindon.
On y perçoit bien comment les artistes sont (mal) perçus dans le monde de l'entreprise. C'est entré en raisonnance avec une discussion que j'avais eue avec mon comptable dans l'après-midi au sujet d'un graphiste indépendant qui "n'avait vraiment pas les pieds sur terre, enfin, vous voyez, c'est un artiste!".
Je me demande souvent pourquoi la société d'ultra-consommation, heureusement périclitante, dans laquelle nous vivons est devenue aussi cruelle avec les artistes, les affublant de tous les épithètes dévalorisants: pas rentables, inutiles, naïfs, rêveurs (terme péjoratif pour elle), un peu cons quoi.
J'ai peut-être une réponse: la recherche de la Beauté et de l'Absolu ne font pas partie de ses grilles d'évaluation, de ses tableurs dénués d'humanité et de son marketing prétentieux. Et c'est bien pour cela qu'elle est en train de s'autodétruire.
Partout, des "résistants" apparaissent, rejetant ce système primaire où seuls des marchands de yaourts décérébrés se retrouvent. Mes messages urbains, modestement, s'inscrivent dans ce mouvement de prise de conscience.
Ce qu'il y a de positif, c'est que cette prise de conscience se fait aussi au sein des décideurs économiques, qui se rendent compte qu'à l'heure où tout le monde fabrique la même soupe flattant les bas instincts du consommateur, l'évolution tangible des chiffres d'affaires se fait à nouveau sur l'innovation et la création, et non sur l'imitation insipide d'un résumé de ce qui marche chez les autres.
Peut-être que cette petite évolution va permettre à nouveau à de très nombreux salariés aux frontières de la dépression, de tendre un peu mieux vers la réalisation d'eux-mêmes. Car quand je parle d'innovation, je ne parle pas que des créatifs. On peut innover à tous les niveaux (au boulot comme ailleurs), ne plus avoir peur du changement et de la nouveauté, ces oxygènes nécessaires à l'entretien de notre feu intérieur, vous savez, cette énergie qui vous faisait vivre si bien l'instant présent quand vous étiez enfant et quand rien ne vous faisait peur...
Et peut-être, du coup, que les artistes, les créatifs, les écrivains, les musiciens retrouveront ainsi leur vraie place et leur utilité sociale: prévoir et montrer le bon chemin par lequel tous s'élever...
samedi 27 octobre 2007
lundi 22 octobre 2007
PLANES
Ce matin en sortant, il faisait assez froid (Un peu comme "THE DAY AFTER", vu la veille) et la luminosité, les odeurs m'ont rappelé ces matins d'hiver, très tôt, lorsque j'attendais le bus pour aller du village au collège puis, plus tard, à Jules Renard.
C'était juste devant la pierre brute où est inscrit le nom du groupe scolaire Guy Môquet (en l'honneur de ce jeune homme mort exactement un 22 octobre pour avoir cru lui aussi en la liberté).
Souvent ces matins-là, pendant que je grelottais, passaient dans le ciel des avions à très haute altitude, leurs trainées rendues très brillantes par la lumière du soleil levant. Et, pour me motiver, je me disais: ce bus, c'est ta carte pour pouvoir un jour être assis, qui sait, dans un de ces avions qui te mènera là où tu rêves d'aller.
Il m'arrive maintenant de penser à ça parfois, quand un avion qui me conduit vers un de mes clients passe au dessus de ma région natale. Je me dis que si ça se trouve, il y a en dessous un(e) collégien(ne), un(e) lycéen(ne) de mon village qui se dit ce que je me disais à cette époque en regardant passer l'avion, duquel j'essaie désespérément de reconnaître la colline qui a perdu toute son altitude vue de si haut.
Aujourd'hui, j'ai eu un message de Thérèse et forcément, un bref instant, en cette fin de journée, je m'imagine à nouveau à la place de ce collégien ou lycéen qui va s'installer au fond du bus, là où on rigole le mieux.
Et comme lui, je ne me rends pas compte que ces habitudes, ces gestes répétés, ces signes, ces bises, ces regards, ces rires, sont des moments d'exception qui s'envoleront très vite, car cette période où tout était possible est finalement une parenthèse si courte au regard des années qui passent...
C'était juste devant la pierre brute où est inscrit le nom du groupe scolaire Guy Môquet (en l'honneur de ce jeune homme mort exactement un 22 octobre pour avoir cru lui aussi en la liberté).
Souvent ces matins-là, pendant que je grelottais, passaient dans le ciel des avions à très haute altitude, leurs trainées rendues très brillantes par la lumière du soleil levant. Et, pour me motiver, je me disais: ce bus, c'est ta carte pour pouvoir un jour être assis, qui sait, dans un de ces avions qui te mènera là où tu rêves d'aller.
Il m'arrive maintenant de penser à ça parfois, quand un avion qui me conduit vers un de mes clients passe au dessus de ma région natale. Je me dis que si ça se trouve, il y a en dessous un(e) collégien(ne), un(e) lycéen(ne) de mon village qui se dit ce que je me disais à cette époque en regardant passer l'avion, duquel j'essaie désespérément de reconnaître la colline qui a perdu toute son altitude vue de si haut.
Aujourd'hui, j'ai eu un message de Thérèse et forcément, un bref instant, en cette fin de journée, je m'imagine à nouveau à la place de ce collégien ou lycéen qui va s'installer au fond du bus, là où on rigole le mieux.
Et comme lui, je ne me rends pas compte que ces habitudes, ces gestes répétés, ces signes, ces bises, ces regards, ces rires, sont des moments d'exception qui s'envoleront très vite, car cette période où tout était possible est finalement une parenthèse si courte au regard des années qui passent...
mardi 16 octobre 2007
ETERNAL MARK
Qu'il soit exceptionnel ou ordinaire, tout le monde a un destin à accomplir. Et ce destin se constitue souvent par strates, comme un escalier dont les marches sont ponctuées d'évènements, de signes alimentant notre réflexion, ou encore de rencontres qui réveillent notre conscience.
Marc a été l'une de ces rencontres. On a été dans la même classe pendant 3 ans, à Jules. C'était une de ces personnes atypiques et intérieurement torturées qui traversent l'existence comme si c'était un jeu. Il avait une grande culture et nous avions de longues discussions philosophiques comme on n'en a plus après, quand on travaille et que le quotidien nous occupe trop.
C'était aussi un cinéphile et j'ai découvert grâce à lui le cinéma d'avant, une culture classique que je n'avais pas. Toutes les semaines, nous nous amusions à choisir quels cours nous allions sécher pour filer voir un film au Mazarin ou à la Maison de la Culture.
Après le bac, on s'est perdus de vue, chacun suivant son chemin. Et je n'avais pas de nouvelles depuis hier.
Hier donc, j'ai échangé des mails avec Philippe, qui vit en Norvège chez mes cousins les vickings et qui a bien connu Marc.
Il m'a appris que Marc s'était suicidé il y a déjà quelques années.
Je crois qu'il y a des tas de films que je ne pourrais plus revoir sans penser à lui.
Marc, j'espère que là où tu es, tu as mis fin à toutes tes souffrances intérieures et que tu es enfin libre...
Je vais écouter pour toi "free bird" de Lynyrd Skynyrd, peut-être que tu l'entendras.
Be free as a bird. And this bird they'll never change.
Marc a été l'une de ces rencontres. On a été dans la même classe pendant 3 ans, à Jules. C'était une de ces personnes atypiques et intérieurement torturées qui traversent l'existence comme si c'était un jeu. Il avait une grande culture et nous avions de longues discussions philosophiques comme on n'en a plus après, quand on travaille et que le quotidien nous occupe trop.
C'était aussi un cinéphile et j'ai découvert grâce à lui le cinéma d'avant, une culture classique que je n'avais pas. Toutes les semaines, nous nous amusions à choisir quels cours nous allions sécher pour filer voir un film au Mazarin ou à la Maison de la Culture.
Après le bac, on s'est perdus de vue, chacun suivant son chemin. Et je n'avais pas de nouvelles depuis hier.
Hier donc, j'ai échangé des mails avec Philippe, qui vit en Norvège chez mes cousins les vickings et qui a bien connu Marc.
Il m'a appris que Marc s'était suicidé il y a déjà quelques années.
Je crois qu'il y a des tas de films que je ne pourrais plus revoir sans penser à lui.
Marc, j'espère que là où tu es, tu as mis fin à toutes tes souffrances intérieures et que tu es enfin libre...
Je vais écouter pour toi "free bird" de Lynyrd Skynyrd, peut-être que tu l'entendras.
Be free as a bird. And this bird they'll never change.
samedi 13 octobre 2007
NICKNAMES
Dans le Street Art, tout le monde a un pseudo, voire plusieurs.
Ca fait partie du jeu et puis maintenant que dans certaines villes importantes, il y a des types qui sont payés pour répertorier tout ce qu'ils appellent les dégradations sur murs et mobiliers urbains, pour ensuite te présenter la note quand tu te fais piquer, il vaut mieux se cacher derrière des identités imaginaires.
Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle une discussion qu'on avait eu en famille à table, un de ces longs dimanches où les repas n'en finissaient pas. On parlait des surnoms.
Dans mon bled, il y avait une tradition (qui disparaît peu à peu) de donner des surnoms à tout le monde. Je pense que ça tenait au fait qu'il y avait pas mal de familles nombreuses et que quand 3 ou 4 frères travaillaient dans la même usine, les surnoms permettaient de ne pas les nommer par leur nom de famille, qui était le même, et ça évitait la confusion.
Il m'en revient quelques uns, portés souvent par des personnages hauts en couleur:
LE PLUME: c'était un gars du village qui avait un petit gabarit. On le voyait faire des zigzag avec sa vieille bécane quand il remontait du café, un coup dans le pif.
PEPETTE: un célibataire endurci, le tombeur des bals de la Salle des Fêtes.
LE TOCHE: un vieil alcoolo d'une petite ville voisine dont le jumeau monozygote était curé. Impossible de les distinguer, sauf par leur tenue et leur degré d'état d'ébriété (le curé picolait aussi mais beaucoup moins). Quand on saluait le Toche en lui disant "Bonjour, Monsieur le Curé", il se mettait à gesticuler sur sa mobylette en nous insultant.
LA MÈRE LA SOUPE: une femme qui sentait toujours une transpiration âcre et écoeurante. Vous la preniez en stop et vous étiez condamné à rouler une semaine avec les vitres ouvertes.
BOIS D'BOUT: C'était un négociant en vins de Vauzelles qui avait le droit de faire consommer du vin tiré des tonneaux mais, comme il n'avait pas de licence IV, la loi interdisait de s'asseoir (donc "bois debout").
DUDULE: un vieil homo qui vivait seul avec sa mère (mais il n'y a pas de rue Sarasate dans le village!).
LA PARME: une dame d'origine italienne (de Parme j'imagine) et qui avait un morceau d'os de crâne en moins. Quand elle se baissait, on voyait sa peau tendue qui tapait à cet endroit-là (j'étais tout petit et ça me foutait une de ces trouilles!)
BOUT-DUR: Je ne vais pas faire de dessin, c'était un vieil obsédé qui ne manquait jamais de rendre visite aux femmes esseulées, sans aucune limite d'âge ni considération esthétique (il aurait été bien prétentieux de faire le difficile, vu la touche qu'il avait!).
On le reconnaissait à son baisenville et ses moustaches recourbées vers le haut. Paraît-il qu'il avait une moumoutte mais je ne sais pas si c'est vrai.
Souvent, quand un nouveau facteur demandait où habitait l'un de ces personnages en citant son vrai nom, même les voisins qui le connaissaient depuis une éternité cherchaient un petit moment avant de répondre, tellement on ne les connaissait que sous leur surnom.
Beaucoup de ces gens sont morts aujourd'hui (2 cas sur 3 à cause de la picole). Et maintenant, c'est le contraire: on ne les connaît plus que sous leur vrai nom, celui qui est gravé sur leur tombe.
Leur surnom, qui faisait leur identité dans ces petites communautés, finit de se dissoudre dans les mémoires de ceux qui restent encore...
Ca fait partie du jeu et puis maintenant que dans certaines villes importantes, il y a des types qui sont payés pour répertorier tout ce qu'ils appellent les dégradations sur murs et mobiliers urbains, pour ensuite te présenter la note quand tu te fais piquer, il vaut mieux se cacher derrière des identités imaginaires.
Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle une discussion qu'on avait eu en famille à table, un de ces longs dimanches où les repas n'en finissaient pas. On parlait des surnoms.
Dans mon bled, il y avait une tradition (qui disparaît peu à peu) de donner des surnoms à tout le monde. Je pense que ça tenait au fait qu'il y avait pas mal de familles nombreuses et que quand 3 ou 4 frères travaillaient dans la même usine, les surnoms permettaient de ne pas les nommer par leur nom de famille, qui était le même, et ça évitait la confusion.
Il m'en revient quelques uns, portés souvent par des personnages hauts en couleur:
LE PLUME: c'était un gars du village qui avait un petit gabarit. On le voyait faire des zigzag avec sa vieille bécane quand il remontait du café, un coup dans le pif.
PEPETTE: un célibataire endurci, le tombeur des bals de la Salle des Fêtes.
LE TOCHE: un vieil alcoolo d'une petite ville voisine dont le jumeau monozygote était curé. Impossible de les distinguer, sauf par leur tenue et leur degré d'état d'ébriété (le curé picolait aussi mais beaucoup moins). Quand on saluait le Toche en lui disant "Bonjour, Monsieur le Curé", il se mettait à gesticuler sur sa mobylette en nous insultant.
LA MÈRE LA SOUPE: une femme qui sentait toujours une transpiration âcre et écoeurante. Vous la preniez en stop et vous étiez condamné à rouler une semaine avec les vitres ouvertes.
BOIS D'BOUT: C'était un négociant en vins de Vauzelles qui avait le droit de faire consommer du vin tiré des tonneaux mais, comme il n'avait pas de licence IV, la loi interdisait de s'asseoir (donc "bois debout").
DUDULE: un vieil homo qui vivait seul avec sa mère (mais il n'y a pas de rue Sarasate dans le village!).
LA PARME: une dame d'origine italienne (de Parme j'imagine) et qui avait un morceau d'os de crâne en moins. Quand elle se baissait, on voyait sa peau tendue qui tapait à cet endroit-là (j'étais tout petit et ça me foutait une de ces trouilles!)
BOUT-DUR: Je ne vais pas faire de dessin, c'était un vieil obsédé qui ne manquait jamais de rendre visite aux femmes esseulées, sans aucune limite d'âge ni considération esthétique (il aurait été bien prétentieux de faire le difficile, vu la touche qu'il avait!).
On le reconnaissait à son baisenville et ses moustaches recourbées vers le haut. Paraît-il qu'il avait une moumoutte mais je ne sais pas si c'est vrai.
Souvent, quand un nouveau facteur demandait où habitait l'un de ces personnages en citant son vrai nom, même les voisins qui le connaissaient depuis une éternité cherchaient un petit moment avant de répondre, tellement on ne les connaissait que sous leur surnom.
Beaucoup de ces gens sont morts aujourd'hui (2 cas sur 3 à cause de la picole). Et maintenant, c'est le contraire: on ne les connaît plus que sous leur vrai nom, celui qui est gravé sur leur tombe.
Leur surnom, qui faisait leur identité dans ces petites communautés, finit de se dissoudre dans les mémoires de ceux qui restent encore...
vendredi 12 octobre 2007
UGLY GEORGE
J'ai l'ouie fine et souvent j'entends des bribes de conversations (comme l'ange dans les Ailes du Désir). Tout cela mis bout à bout raconte parfois d'étranges histoires qui alimentent mes collages pop-surréalistes.
Mais ma phrase de la semaine, c'est quand même celle-ci, émanant d'une femme élégante mais avec pas mal de kilométrage, et à la bouche étrangement déformée par l'aigreur:
"Mais qu'est-ce qu'il est laid, ce George Clooney, je ne comprends vraiment pas ce qu'on lui trouve!"
Cela alimente évidemment ma réflexion quasi permanente sur le manque de goût, malheureusement trop souvent associé à la prétention d'en avoir plus que les autres.
Mais ma phrase de la semaine, c'est quand même celle-ci, émanant d'une femme élégante mais avec pas mal de kilométrage, et à la bouche étrangement déformée par l'aigreur:
"Mais qu'est-ce qu'il est laid, ce George Clooney, je ne comprends vraiment pas ce qu'on lui trouve!"
Cela alimente évidemment ma réflexion quasi permanente sur le manque de goût, malheureusement trop souvent associé à la prétention d'en avoir plus que les autres.
PINKY TOWN
Il paraît que les femmes qui s'habillent souvent en rose manquent cruellement d'affection.
C'est bon à savoir, non?
C'est bon à savoir, non?
jeudi 11 octobre 2007
WOODEN WORLD
Quand j'étais gamin, j'adorais grimper dans les arbres. J'étais même devenu plutôt habile, avec ma silhouette de crevette, pour monter jusque vers les branches les plus fines et me rendre invisible du monde des adultes.
Dans l'énorme noisetier qui est là depuis si longtemps devant la maison de mes parents, les grands passaient en dessous, discutaient, me cherchaient parfois, sans se rendre compte que je les survolais, comme un ange, entendant des choses que je n'aurais peut-être pas dû entendre.
Ma passion des arbres m'avait conduit à installer sur la Colline, quelques "bases secrètes" (des cabanes succinctes faites de vieilles planches récupérées) où on se retrouvait avec 2 ou 3 copains (Skateslipper, Doctor JL et Loborman).
Il y en avait une dans le bois, près de la maison en ruines. Une autre dans un verger en friches pas loin du château d'eau. Et une troisième près du panorama, au bout de la colline, la mieux cachée.
On avait évidemment d'autres bases secrètes: l'ancienne maison d'un garde-chasse (à l'époque abandonnée), la cabane du Crâne, la grotte, bien sûr, et puis la clairière des Renards.
Ca fait un bail que je ne suis pas repassé par tous ces endroits. Cela vaut peut-être mieux car le temps a sans doute fait des siennes. A part la grotte, toujours immuable, n'est-ce pas, Alyanie?
Aujourd'hui Loborman est architecte à Bordeaux, Doctor JL est devenu schizo et Skateslipper un champion d'athlétisme. Je ne les ai pas vus depuis une éternité.
Mais ce qui me rend le plus triste, c'est que l'autre jour, j'ai vu un arbre qui m'a donné l'envie d'y grimper. Et je ne l'ai pas fait, de peur d'abimer ma veste Zadig & Voltaire et mes baskets collector.
Dans l'énorme noisetier qui est là depuis si longtemps devant la maison de mes parents, les grands passaient en dessous, discutaient, me cherchaient parfois, sans se rendre compte que je les survolais, comme un ange, entendant des choses que je n'aurais peut-être pas dû entendre.
Ma passion des arbres m'avait conduit à installer sur la Colline, quelques "bases secrètes" (des cabanes succinctes faites de vieilles planches récupérées) où on se retrouvait avec 2 ou 3 copains (Skateslipper, Doctor JL et Loborman).
Il y en avait une dans le bois, près de la maison en ruines. Une autre dans un verger en friches pas loin du château d'eau. Et une troisième près du panorama, au bout de la colline, la mieux cachée.
On avait évidemment d'autres bases secrètes: l'ancienne maison d'un garde-chasse (à l'époque abandonnée), la cabane du Crâne, la grotte, bien sûr, et puis la clairière des Renards.
Ca fait un bail que je ne suis pas repassé par tous ces endroits. Cela vaut peut-être mieux car le temps a sans doute fait des siennes. A part la grotte, toujours immuable, n'est-ce pas, Alyanie?
Aujourd'hui Loborman est architecte à Bordeaux, Doctor JL est devenu schizo et Skateslipper un champion d'athlétisme. Je ne les ai pas vus depuis une éternité.
Mais ce qui me rend le plus triste, c'est que l'autre jour, j'ai vu un arbre qui m'a donné l'envie d'y grimper. Et je ne l'ai pas fait, de peur d'abimer ma veste Zadig & Voltaire et mes baskets collector.
samedi 6 octobre 2007
LEAD CAP
Ce matin, j'ai un peu la gueule de bois (j'aurais mieux fait de prendre un Pessac-Léognan plutôt que de choisir ce côtes-du-Rhone très moyen).
Cela me rappelle la pire cuite que je me suis prise.
C'était à Vichy. J'étais étudiant en Arts Appliqués et tout le monde dans la classe picolait dur. Je crois que c'était l'anniversaire de Marie-Laurence, ou celui de Lydie, je ne sais plus. En tout cas, c'était chez Marie-Laurence, dans un de ces anciens hôtels qui servaient de ministères pendant l'Occupation et qui avaient été transformés en studios pour étudiants.
Après une mise en bouche, on s'était fini au gin, par bols, mélangé à un peu de jus de citron, pour faire passer. C'était complètement crétin, je sais, et je ne le conseille à personne.
En tout cas, on était déjà complètement murgés en arrivant dans cette boîte du centre-ville où le patron nous faisait entrer gratos, suite à un défilé de mode qu'on avait organisé chez lui.
Puis, tout se mélange un peu. Je me souviens juste que Marie-Laurence, aussi pitoyable que moi, avait cassé le talon d'une de ses nombreuses pompes de marque et qu'elle avait fini par danser pieds nus. Après, ça a été le black-out pendant presque 24 heures. J'ai dû faire un genre de coma éthylique.
J'ai su seulement le lundi matin ce qui c'était passé, en faisant ma petite enquête.
D'abord, je m'étais affalé sur une banquette contre une fille de ma classe que je ne connaissais pas beaucoup et j'avais fini par lui vomir dessus. Puis, sans avoir quitté ma canadienne (c'était le top fashion à ce moment-là) dont je n'avais pas vu que le col en fourrure était décoré du résumé de mon repas du soir déjà digéré, je m'étais dirigé vers la piste où j'avais dû tenter de danser en m'accrochant à tout ce qui passait. Enfin, la fille avec qui je sortais, Diane, m'avait accompagné jusqu'aux lavabos pour me passer la tête sous l'eau et, tant bien que mal, m'avait ramené chez moi, à quelques centaines de mètres...
Je m'étais réveillé le lendemain soir dans mon lit, toujours avec cette foutue canadienne, entouré de charmantes galettes de vomi.
Evidemment, le lundi matin, j'étais la risée de toute l'école et j'ai dû payer le pressing à deux ou trois nanas qui ne m'ont plus d'ailleurs adressé la parole pendant un bon moment.
Quant à la belle Diane, elle avait fini la nuit avec un beauf qui lui offrait des fleurs depuis 2 ou 3 semaines.
Voilà. Le bilan de cette cuite reste quand même plutôt négatif. Depuis j'en ai pris d'autres, bien sûr, mais jamais à ce point. Cette expérience, en fait, m'a appris intuitivement où je dois m'arrêter lors de soirées où ça picole, pour qu'elles restent de relativement bons souvenirs. Il vaut mieux éviter la loose, même pour une ou deux heures où le cerveau voyage dans "le monde d'à côté"...
Bon, je retourne me prendre un Ibuprofène. Je ne voudrais pas flinguer le reste du weekend.
Cela me rappelle la pire cuite que je me suis prise.
C'était à Vichy. J'étais étudiant en Arts Appliqués et tout le monde dans la classe picolait dur. Je crois que c'était l'anniversaire de Marie-Laurence, ou celui de Lydie, je ne sais plus. En tout cas, c'était chez Marie-Laurence, dans un de ces anciens hôtels qui servaient de ministères pendant l'Occupation et qui avaient été transformés en studios pour étudiants.
Après une mise en bouche, on s'était fini au gin, par bols, mélangé à un peu de jus de citron, pour faire passer. C'était complètement crétin, je sais, et je ne le conseille à personne.
En tout cas, on était déjà complètement murgés en arrivant dans cette boîte du centre-ville où le patron nous faisait entrer gratos, suite à un défilé de mode qu'on avait organisé chez lui.
Puis, tout se mélange un peu. Je me souviens juste que Marie-Laurence, aussi pitoyable que moi, avait cassé le talon d'une de ses nombreuses pompes de marque et qu'elle avait fini par danser pieds nus. Après, ça a été le black-out pendant presque 24 heures. J'ai dû faire un genre de coma éthylique.
J'ai su seulement le lundi matin ce qui c'était passé, en faisant ma petite enquête.
D'abord, je m'étais affalé sur une banquette contre une fille de ma classe que je ne connaissais pas beaucoup et j'avais fini par lui vomir dessus. Puis, sans avoir quitté ma canadienne (c'était le top fashion à ce moment-là) dont je n'avais pas vu que le col en fourrure était décoré du résumé de mon repas du soir déjà digéré, je m'étais dirigé vers la piste où j'avais dû tenter de danser en m'accrochant à tout ce qui passait. Enfin, la fille avec qui je sortais, Diane, m'avait accompagné jusqu'aux lavabos pour me passer la tête sous l'eau et, tant bien que mal, m'avait ramené chez moi, à quelques centaines de mètres...
Je m'étais réveillé le lendemain soir dans mon lit, toujours avec cette foutue canadienne, entouré de charmantes galettes de vomi.
Evidemment, le lundi matin, j'étais la risée de toute l'école et j'ai dû payer le pressing à deux ou trois nanas qui ne m'ont plus d'ailleurs adressé la parole pendant un bon moment.
Quant à la belle Diane, elle avait fini la nuit avec un beauf qui lui offrait des fleurs depuis 2 ou 3 semaines.
Voilà. Le bilan de cette cuite reste quand même plutôt négatif. Depuis j'en ai pris d'autres, bien sûr, mais jamais à ce point. Cette expérience, en fait, m'a appris intuitivement où je dois m'arrêter lors de soirées où ça picole, pour qu'elles restent de relativement bons souvenirs. Il vaut mieux éviter la loose, même pour une ou deux heures où le cerveau voyage dans "le monde d'à côté"...
Bon, je retourne me prendre un Ibuprofène. Je ne voudrais pas flinguer le reste du weekend.
Inscription à :
Articles (Atom)